
Il n’aura fallu qu’une semaine pour assister à la chute d’un village de paysans vivant en autarcie, subsistant grâce à leurs terres et à leurs récoltes.
Tout bascule avec l’arrivée de propriétaires terriens venus réclamer leur dû au nom du « progrès ». Et on ne le dira jamais assez : le capitalisme abîme et dénature tout.
Nombreux sont les films qui dénoncent ce système, mais celui-ci arrive à le faire autrement.
La colorimétrie est sublime. Le choix du 16mm, avec ses bordures visibles permet de renforcer le caractère rustique de la terre et permet au spectateur de ressentir tout le côté rudimentaire et la beauté brute du lieu. Ici, l’image est un parti pris à part entière. Sans ça, Harvest ne m’aurait pas autant séduite. La réalisation soignée ajoute un côté illuminé, conférant à l’ensemble une dimension à la fois utopique et théâtrale. On se laisse porter, happé par cette fable surréaliste.
À travers son récit, Harvest ne prétend pas que le monde d’avant était parfait, mais il démontre qu’il laissait encore la possibilité à ceux qui refusaient la ville de rester sur leurs terres et de continuer à les cultiver à leur rythme. Jusqu’au jour où la société elle-même les rattrape, arrive à eux pour les bousculer dans leur quotidien et briser définitivement cet équilibre.
Ici, le progrès est dépeint comme une force destructrice qui détruit tout sur son passage : les champs, la verdure, les forêts qui abritent une faune et une flore fragiles, pour les remplacer par des constructions uniformes et sans âme. Tout cela à des fins de rendement, pour enrichir les capitalistes et remplir leurs poches. Même Picsou aurait plus d’éthique.
La beauté d’un lieu idyllique, aux paysages tout droit sortis d’un conte de fées, finit ainsi annihilée, comme si cette nature sauvage n’était pas la plus belle richesse que la terre ait portée, simplement parce qu’elle n’a pas une quelconque utilité dans la marche supposée de la progression de la société.
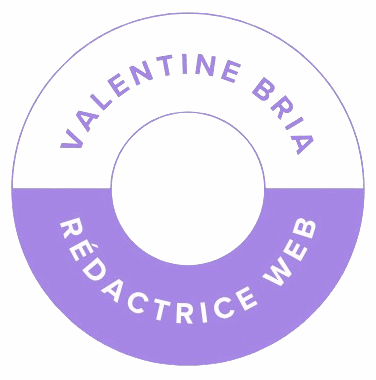
Soyez le premier à commenter